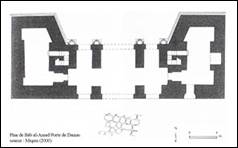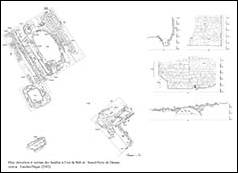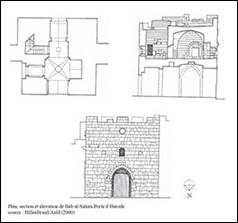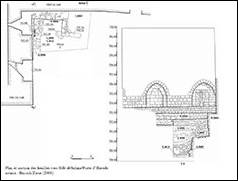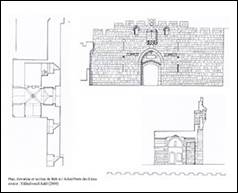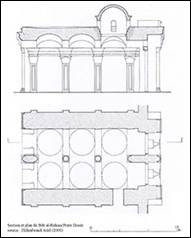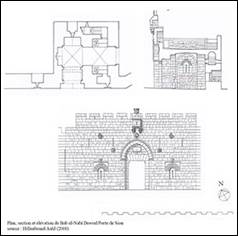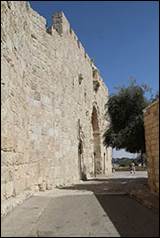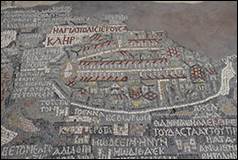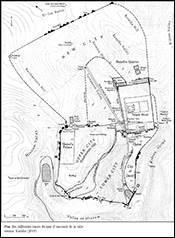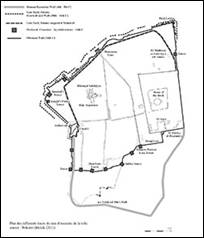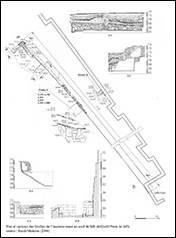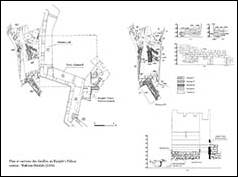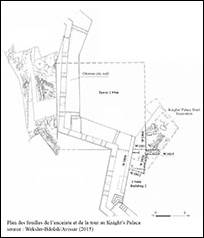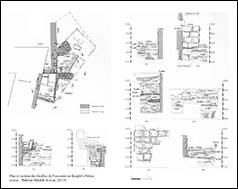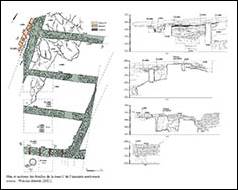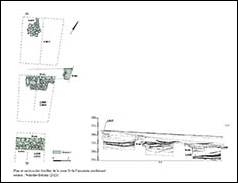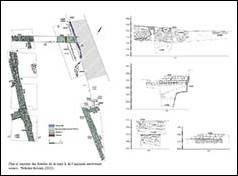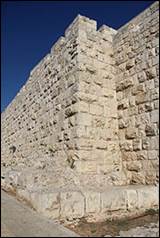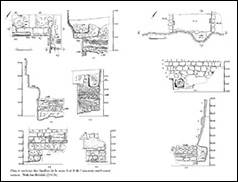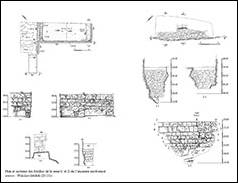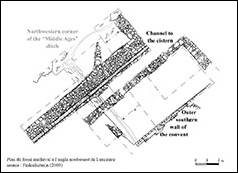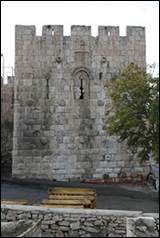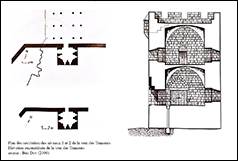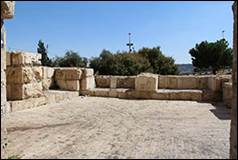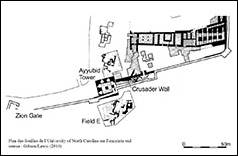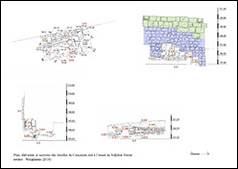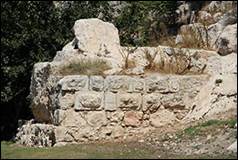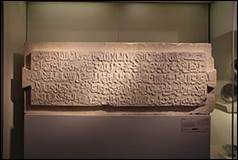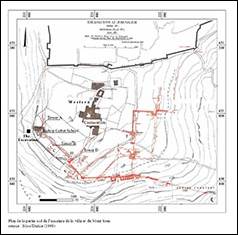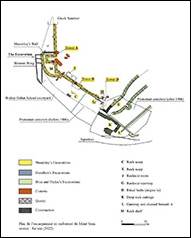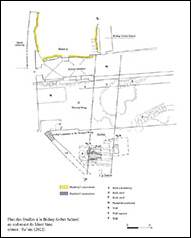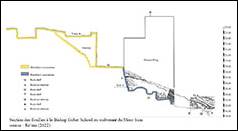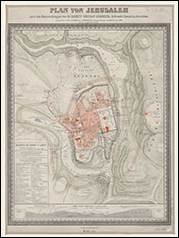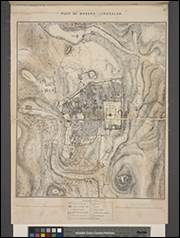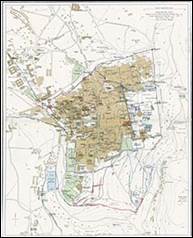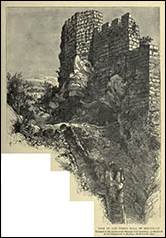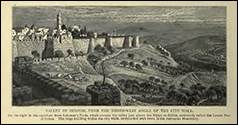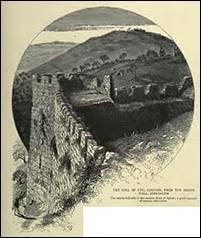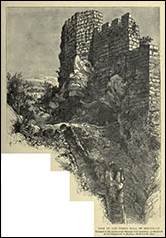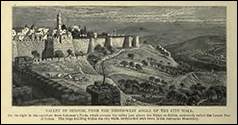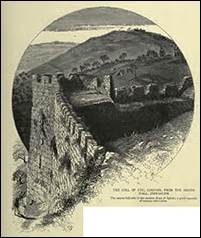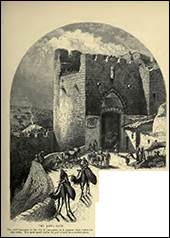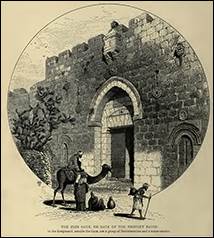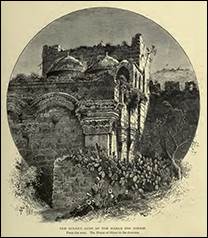Mur d’enceinte, tours et portes de la ville (n.d.)
Localisation : mur d’enceinte entourant la Vieille Ville sur 4,5km, percé de huit portes.
Réf :
Berchem (1922)
Bieberstein/Bloedhorn (1994) I, p.216
Bieberstein/Bloedhorn (1994) II, p.69, 79, 86, 90, 93, 114-117, 166, 243-245, 333, 383
Bliss/Dickie (1898)
Broshi (1977), p.13-17
Broshi (1987), p.299-303
Broshi/Tsafrir (1977), p.28-37
Hamilton (1944), p.1-54
Hennessy
(1970), p.237-246
Korn (2004), n°8, 9, 18, 25, 37
Mitchell
(1920), p.28-50
Pierotti
(1864)
Saulcy (1865), II, p.39-60
Wilson (1866)
Wilson (1881), I
Berchem (1922), n°40, 43, 150
Broshi (1976), p.75-78
Broshi (1987), p.299-303
Burgoyne/Abul-Hajj (1979), n°15, 16, 18
RCEA 3447, 3515, 3517
Sharon (1977), p.179-193
TEI, n°8178, 8247, 8250, 32837, 32749, 32751, 32755, 41112
Walls/Abu-Hajj (1980), n°16, 18, 19, 40, 43, 150
Wiet (1922), n°16
Historique
Période
antérieure
L’enceinte est mentionnée par les
voyageurs et explorateurs du 19e siècle, son étude débute aussi à la
fin de cette période.[1]
Depuis les années 1990 elle fait l’objet de recherches[2]
et les sondages et fouilles opérés par le Service des Antiquités Israéliennes
sont régulièrement publiées.[3]
Une enceinte est déjà avérée sur la mosaïque de Madaba (ill.1) incluant la Cité
de David, l’Ophel et le Mont Sion (ill.2). On retrouve aujourd’hui ces vestiges
en plusieurs points de la ville. On distingue trois grandes phases de
construction :
Une phase romano-byzantine.[4]
Une phase Abbasside-Fatimide.[5]
Une phase Croisée et Ayyûbide avant la
reconstruction totale par les Ottomans.[6]
A la veille de la conquête croisée, les
murs semblent suivre le parcours des futurs murs Ottomans (ill.3). Un important
séisme endommage l’ensemble en 424/1033, les réparations seront achevées en
455/1063.
Deux sources principales permettent de
restituer l’enceinte et les portes sous les Ayyûbides et les Mamluk : la
biographie de la ville par Mujîr al-Dîn[7]
et les Sijillât.[8]
Période
Ayyûbide
Saladin conquiert Jérusalem entre le 9-17 rajab 583/20.IX-2.X.1187. La menace de la troisième
Croisade cinq ans plus tard le contraint à restaurer les murs de la ville entre
dhu’l-hijja 587-ramadan 588/Décembre
1191-Octobre 1192, il étend aussi le front sud en englobant le Mont Sion
(ill.4). Ces faits sont confirmés par des témoignages de pèlerins Occidentaux
en voyage à l’époque[9],
et par plusieurs inscriptions datées 587-588/1191-1192, dont celle de la Qubba al-Yûsuf sur le Haram (ill.84). Par la suite l’histoire du
mur est un peu décousue.
En 595/1198 une inscription mentionne des
travaux sans plus détails.
En 599-600/1202-1203 des travaux sont
mentionnés sur deux inscriptions.
En 609-610/1212-1214 une restauration du
front sud est documentée par une inscription du sultan al-Mu’azzam ‘Isâ
(r.615/1217-624/1227), datée 610/1213 et découverte vers Bâb Dawûd en 1974 (ill.83).[10]
En 616/1219 le sultan Ayyûbide al-Mu’azzam
‘Isâ (r.615/1218-624/1227) fait raser les murs de la ville à partir du 1
muharram 616/19.III.1219.[11]
En 626/1229 la ville est rendue aux
Croisés mais sans les murs.
En 644/1247 le sultan al-Sâlih Ayyûb (2e règne
643/1245-647/1249) propose un plan, sans lendemain, de refortification de la
ville.
Les murs à l’époque Ayyûbide ne semblent
pas suivre le même parcours sur le front ouest que celui d’aujourd’hui, des
sources mentionnent la Citadelle comme étant hors
les murs et de nombreux quartiers de la ville (Harât Jawalida, Zara’îna, Mawlât, et Maghrabîya)
sont situés extra-muros puis sont mentionnés comme intra-muros sous les Mamluk.
Le mur d’enceinte Ayyûbide intègre des
tours carrées et massives, au sud il englobe aussi le Mont Sion, les fronts
nord et nord-est sont protégés par un fossé creusé dans la roche dont on voit
les traces face au Musée Rockefeller notamment. Le mur du Haram se substitue au mur d’enceinte sur une grande
partie du front est et une partie du front sud-est.
Les nombreux sondages et fouilles de ces
dernières années ont révélés plusieurs vestiges de mur et de tours Ayyûbides
(en partant de Bâb al-Khalîl vers le nord) :
Une base de tour avec une section du mur
d’enceinte parallèle au mur Ottoman sous l’actuelle Bâb al-Khalîl/Porte de
Jaffa (ill.4-7). Le mur d’enceinte est en partie élevé et excavé sur les
vestiges d’un bain Byzantin, utilisé jusqu’au 7e siècle et d’un
aqueduc en usage jusqu’au début du 12e siècle, ce mur reprend des
blocs antérieurs et présente des vestiges de destruction et d’éboulements
consécutifs aux destructions de la muraille par le sultan al-Mu’azzam ‘Isâ en
616/1219.[12]
Une partie du mur Ayyûbide à quelques
mètres au nord de Bâb al-Khalîl (ill.4, n°1).[13]
Une base de tour, à cheval sur le mur
d’enceinte, dans les jardins de l’hôtel Knight’s
Palace (ill.4, n°2, 3 ; ill.8-10).[14]
Une base de tour à angle nord-ouest en
contrebas du Collège des Frères sur Zahal square et
au sein de l’établissement (ill.4, n°4 ; ill.11-16).[15]
Une section du mur d’enceinte à l’est et à
l’ouest de la Porte Neuve (ill.4, n°6 ; ill.17-19).[16]
Une tour à 130m au nord-est de la Porte
Neuve, peut-être la Poterne de St Lazare (ill.4, n°9).[17]
Une section du mur à 25m à l’est de Bâb
al-‘Amûd (ill.4, n°11, 26 ; ill.2).[18]
Un édifice, côté intra-muros, peut-être
lié au mur (ill.4, n°14).[19]
Une tour au nord Bab al-Asbât, côté intra-muros près de l’église Ste. Anne (ill.4,
n°16).[20]
Une tour-porte à quelques mètres à l’ouest
de la Porte des Immondices peut-être la Porte des Tanneurs (ill.4, n°17 ;
ill.27-36).[21]
Une base de tour entre la tour-porte
précédente et le burj Kibrît/tour Sulfur (ill.4, n°18 ; ill.37, 38).[22]
Une tour devant le burj Kibrît/tour Sulfur
(ill.4, n°19 ; ill.43-46)[23].
Un édifice, à l’est des fouilles de University of North Carolina, peut-être en lien avec le mur
d’enceinte (ill.47).[24]
Une tour à cheval sur le mur d’enceinte
Ottoman en bas de Habbad Street vers un parking. Site
de la découverte de l’inscription du sultan al-Mu’azzam ‘Isa datée 610/1212
(ill.4, n°20 ; ill.52-56, 83).[25]
Une tour au niveau de la Porte de Sion
(ill.4, n°21).[26]
Une tour dans le parking du Patriarcat
Arménien à l’extrémité sud de l’Armenian Patriarch road, (ill.4, n°22 ; ill.59, 60).[27]
Une base de tour à l’angle sud-ouest du
mur d’enceinte (ill.4, n°23 ; ill.62-67).[28]
Une 2e tour à 50m au nord de
l’angle sud-ouest (ill.68, 69).[29]
Une base de tour sur le front ouest, au
sud de la Citadelle et découverte d’une autre inscription datée du sultan
al-Mu’azzam ‘Isa (ill.4, n°24 ; ill.71-77).[30]
Période
Mamluk
Les Mamluk ne s’occupent pas des murs de
la ville, on note seulement de maigres réparations par le sultan al-‘Adîl Kitbugha (r.11 muharram
694/1.XII.1294 – 27 muharram 696/25.XII.1296) en 696/1295 sur le front est du
Haram et en 709/1309 par al-Nâsir Muhammad (2e
règne 6 jumada I 698/9.II.1299 – 22 shawwal 708/4.IV.1309) sur le côté sud du Haram. Cet état
semble confirmé par plusieurs voyageurs Occidentaux et les portes sont
mentionnées comme étant toujours debout.[31]
A partir de 1538, le sultan Ottoman
Sulaiman restaure entièrement le mur d’enceinte et fait construire de nouvelles
tours donnant à la ville intra-muros son aspect extérieur actuel. Les huit
portes, Bâb al-Khalîl/Porte de Jaffa (ill.1-7), Bâb al-Jadîd/Porte
Neuve, Bâb al-‘Amûd/Porte de Damas (ill.1-3), Bâb al-Sahira/Porte de Hérode (ill.1, 2), Bâb al-‘Asbât/Porte St. Etienne (ill.1-3), Bâb al-Rahma/Porte Dorée
(ill.1, 2), Bâb al-Mughrabî/Porte des Immondices et
Bâb al-Nabî Dawûd/Porte de
Sion (ill.1-3) sont conservées ou modifiées.[32]
Epigraphie
587/1191. Qubba Yûsuf, Haram. Texte de restauration 6 lignes (180x90) sur
une dalle sous la niche (ill.84).[33]
« xxx Sa construction et le creusement du fossé
ont été ordonnés par notre maître al-Malik al-Nâsir Salâh al-dunya wa’l-dîn, le
sultan de l’islam et des musulmans, le serviteur des deux nobles sanctuaires et
de ce temple sanctifié, Abul-Muzaffar Yûsuf, fils d’Aiyûb, le vivificateur de
l’empire de l’émir des croyants, - que Dieu fasse durer ses jours et secoure
ses étendards ! – durant les jours de l’émir, du grand maréchal, Saif
al-Dîn ‘Alî, fils d’Ahmad, - que Dieu le glorifie ! – en l’année 587 de
l’hégire du Prophète (1191), sous la surveillance de l’émir Nâsir al-Dîn
Altun-Ba al-Saifî, que Dieu le favorise ! ».
587/1191. Texte de construction 4 lignes
(65x55) anciennement sur le mur d’enceinte de la ville, aujourd’hui inséré dans
le mur du portique ouest du Haram.[34]
« Coran II, 127. [The
construction of this wall was ordered by] His Majesty, al-Malîk al-Nâsir, the
uniter of the w[orld of the Faith, the vanquisher of the servants of the
crosses, Sâlah al-dunya wa’l-dîn] [sultan of Islam] and the Muslims, servant of
the two noble sanctuaries [and this Holy House, Abû’l-Muzaffar Yûsuf son of
Ayyûb] [and that (was) under the supervivion of His Majesty,] al-Malîk al-Zahir
Ghiyâth al-dunya wa’[l-dîn Ghazî in the year …] ».
588/1192. Texte de construction 5 lignes
(63x104) anciennement sur le mur d’enceinte de la ville, aujourd’hui au Musée
Islamique sur le Haram.[35]
« […] the bl[essed]
tower […] [His Majesty al-Mâlik al-Nâsi]r Sâlah al-dunya wa’l-dîn, sultan of
Islam and the Mus[lims …] [… Abû’l-Muzaffar Y]ûsuf son of Ayyûb, restorer of
the Empire of the commander of the Faithfull, may God make eternal [his] days
[…] [… under the supervision of] the illustrious amir Sâbiq al-Dîn ‘Uthman son
of Muhammad al-Majdî … […] ».
588/1192. Texte de construction 5 lignes
(54x70) en 4 fragments anciennement sur le mur d’enceinte de la ville,
aujourd’hui au Musée Islamique sur le Haram.[36]
« […I]slam …’Abdallâh
…] [… al-Malîk] al-Nâsir Salâh al-duniya wa’l-dî[n…] […His Majesty al-Malîk
al-Mu’ayyad al-Muzaffar al-Mans[ûr …] [… under the governorship of the] one in
need of God, Jurdîk son of ‘A[bdallâh …] [ …and] five [hu]ndred. Pr[ai]se be to
God [A]lo[ne …] ».
595/1198. Texte de restauration 2 lignes (30x30) sur une dalle remployée
sur le parement intérieur du mur d’enceinte du jardin du Patriarcat Latin, vers
Saint Sauveur.[37]
« xxx A
été fondé xxx wa’l-dîn, fils de ‘Uthmân xxx ».
595/1198. Texte de construction 4 lignes (40x35) sur une dalle.[38]
« xxx Que Dieu ait pitié de lui ! xxx de
l’islam et des musulmans, ‘Uthmân, fils de xxx, et que Dieu fasse durer leurs
jours et [leur] gouvernement ! xxx Sa’îd Altunba, fils de ‘Abd-[Allâh],
xxx ».
599/1202. Texte de construction 4 lignes (160x68 partie droite manquante), découvert en 1973-1974 à 160m au nord de l’angle sud-ouest de l’enceinte.[39]
Texte
non disponible.
610/1212. Texte de restauration 5 lignes (270x90), découvert en 1971 à l’est de Bâb Dawûd et conservé au Musée National (ill.83).[40]
Texte non disponible.
Biblio complémentaire :
Wightman (1993)
Broshi/Gibson (1994), p.147-155
Geva/Bahat
(1998), p.223-235
Ben Dov
(2000), p.311-332
Hillenbrand/Auld
(2000)
Magen
(2000), p.281-288
Avni/Baruch (2001), p.76-79
Seligman (2001), p.262-273
Seligman (2002), p.73-85
Ghosheh
(2004), p.117-137
Weksler-Bdolah
(2005a)
Baruch/Zissu (2006)
Reich/Shukon
(2006)
Weksler-Bdolah
(2006)
Baruch/Weiss
(2009)
Colakoglu
(2009), p.193-209
Finkielsztejn
(2009), p.5-8
Tabbaa
(2009), p.460-469
Avner
(2011)
Sion/Puni
(2011)
Weksler-Bdolah
(2011)
Weksler-Bdolah
(2011a)
Kloner
(2013), n°396, 397
Barbé/Vitto
(2014), p.32-44
Sion/Rapuano
(2014)
Weksler-Bdolah (2014),
p.417-451
Weksler-Bdolah (2015), p.68-107
Gibson/Lewis (2016), p.39-55
Wiegmann (2016)
Re’em (2018)
Avner (2020)
Re’em (2021), p.249-293
Weksler-Bdolah (2021),
p.193-210
Landes-Nagar (2022)
Re’em (2022)
Tarragon (2022), p.121-139
Uziel/Roth (2023), p.87-105
https://www.antiquities.org.il/jerusalemwalls/about_eng.asp
Illustrations de Bâb al-Khalîl/Porte de Jaffa
|
|
|
|
|
|
1/ plan de Bâb al-Khalîl/Porte de Jaffa |
2/ vue de Bâb al-Khalîl depuis le nord-ouest |
3/ vue de Bâb al-Kahlîl depuis l’ouest |
4/ les vestiges découverts sous Bâb al-Khalîl depuis
l’ouest |
|
|
|
|
|
5/ la base d’une tour sous Bâb al-Khalîl depuis le
nord-ouest |
6/ la base d’une tour sous Bâb al-Khalîl depuis le
nord-ouest |
7/ la base d’une tour sous Bâb al-Khalîl avec le mur
d’enceinte depuis l’ouest |
Illustrations Bâb al-‘Amûd/Porte de Damas
|
|
|
|
|
1/ plan de
Bâb al-‘Amud/Porte de Damas |
2/ plan des fouilles à Bâb al-‘Amûd |
3/ vue de Bâb al-‘Amud depuis le nord |
Illustration de Bâb al-Sahira/Porte de Hérode
Illustrations de Bâb al-‘Asbat/Porte de St. Etienne
|
|
|
|
|
1/ plan de Bâb al-‘Asbat/Porte de St. Etienne |
2/ Bâb al-‘Asbat extra-muros |
3/ Bâb al-‘Asbat intra-muros, depuis le sud |
Illustrations de Bâb al-Rahma/Porte Dorée
Illustrations Bâb al-Nabî Dawûd/Porte de Sion
|
|
|
|
|
1/ plan de Bâb al-Nabî Dawûd/Porte de Sion |
2/ Bâb al-Nabî Dawûd depuis l’ouest |
3/ l’accès à Bâb al-Nabî Dawûd, coté extra-muros |
Illustrations de l’enceinte
|
|
|
|
|
|
1/ Jérusalem sur la mosaïque de Madaba |
2/ plan des différents tracés de l’enceinte |
3/ plan des différents tracés de l’enceinte |
4/ plan des vestiges médiévaux et des fouilles de
l’enceinte |
|
|
|
|
|
|
|
5/ plan de fouilles au nord de Bâb al-Khalîl |
6/ le front nord-ouest depuis le sud |
7/ une tour du front nord-ouest avec l’inscription
de construction Ottomane |
8/ plan des fouilles en 2006 au Knight’s Palace |
9/ plan des fouilles en 2015 au Knight’s Palace |
|
|
|
|
|
|
|
10/ plan des fouilles au Knight’s Palace en 2015 |
11/ plan des fouilles de la zone C à Zahal square en
2021 |
12/ / plan des fouilles de la zone D à Zahal square
en 2021 |
13/ plan des fouilles de la zone E à Zahal square en
2021 |
14/ vue de l’angle nord-ouest de l’enceinte depuis
le nord |
|
|
|
|
|
|
|
15/ vue de l’angle nord-ouest de l’enceinte à Zahal
square |
16/ une base de tour à l’angle nord-ouest à Zahal
square |
17/ plan des fouilles de la zone A et B autour de la
Porte Neuve en 2011 |
18/ plan des fouilles de la zone C et D autour de la
Porte Neuve en 2011 |
19/ plan des fouilles du fossé au nord-ouest de
l’enceinte |
|
|
|
|
|
|
|
20/ une tour Ottomane et son inscription sur le
front nord |
21/ plan de la tour Laqlaq à l’angle nord-est |
22/ la façade est de la tour Laqlaq |
23/ vue de la tour Laqlaq depuis le sud-est |
24/ le front nord-est depuis le sud |
|
|
|
|
|
|
|
25/ le front nord-est et ses tours |
26/ le front nord-est au nord de Bâb al-‘Asbat |
27/ plan de la tour-porte des Tanneurs |
28/ plan des fouilles à la tour-porte |
29/ la tour porte (plan n°17) depuis le sud |
|
|
|
|
|
|
|
30/ la façade sud de la tour-porte |
31/ la tour-porte depuis le sud-est |
32/ la façade est de la tour-porte |
33/ l’intérieur de la tour-porte depuis l’ouest, à
gauche l’accès intramuros |
34/ l’intérieur de la tour-porte depuis le sud |
|
|
|
|
|
|
|
35/ le mur d’enceinte sud en direction du sud-ouest
depuis la tour-porte |
36/ le mur d’enceinte sud en direction du nord-est |
37/ base de la tour médiévale entre la tour-porte et
burj Kibrit depuis l’est |
38/ base de la tour médiévale depuis le sud |
39/ le mur d’enceinte au sud de la base de tour
médiévale |
|
|
|
|
|
|
|
40/ le mur d’enceinte au sud de la base de la tour
médiévale |
41/ la base de tour et la tour au nord du burj
Kibrit |
42/ détail de la base de tour et de la tour |
43/ le burj Kibrit/Sulfur depuis l’est |
44/ vue de burj Kibrit depuis le sud-est |
|
|
|
|
|
|
|
45/ la façade du burj Kibrit |
46/ le burj Kibrit depuis l’ouest |
47/ plan de la tour médiévale et du secteur des
fouilles de l’University of North Carolina |
48/ l’enceinte sud au niveau des fouilles en
direction de l’ouest |
49/ l’enceinte sud en direction du burj Kibrit |
|
|
|
|
|
|
|
50/ l’enceinte sud avec la tour Ottomane, à arrière
la tour médiévale au sud de Habbad street |
51/ l’enceinte sud et la tour Ottomane depuis le
sud-ouest |
52/ la base du mur d’enceinte face aux fouilles de
UNC |
53/ la tour médiévale au sud de Habbad street depuis
l’ouest |
54/ la tour médiévale au sud de Habbad street depuis
l’ouest |
|
|
|
|
|
|
|
55/ la tour médiévale au sud de Habbad street depuis
le nord |
56/ l’intérieur de la tour médiévale depuis le
sud-est |
57/ plan des fouilles dans le secteur de la tour
médiévale |
58/ l’enceinte sud à l’est de Bâb al-Nabî
Dawûd/Porte de Sion |
59/ la tour au sud de Patriarcat street, côté
extra-muros |
|
|
|
|
|
|
|
60/ la tour au sud de Patriarcat street, côté
intra-muros depuis le nord |
61/ l’enceinte sud avec la tour au sud de Patriarcat
street |
62/ l’angle sud-ouest de l’enceinte |
63/ la base de la tour médiévale à l’angle sud-ouest
de l’enceinte |
64/ la base de tour médiévale depuis l’ouest |
|
|
|
|
|
|
|
65/ la base de la tour médiévale depuis le sud-ouest |
66/ la tour à l’angle sud-ouest de l’enceinte, côté
intra-muros (parking du quartier Arménien) |
67/ la tour à l’angle sud-ouest de l’enceinte, côté
intra-muros depuis l’est |
68/ la 2e tour de l’angle sud-ouest de
l’enceinte, côté intra-muros |
69/ la 2e tour de l’angle sud-ouest de
l’enceinte, côté intra-muros depuis l’est |
|
|
|
|
|
|
|
70/ la courtine médiévale de l’enceinte ouest au sud
de la tour médiévale |
71/ la tour médiévale de l’enceinte ouest |
72/ vestiges sur le côté nord de la tour médiévale |
73/ vue de la tour médiévale depuis le nord avec les
vestiges |
74/ la courtine de l’enceinte ouest entre la tour
médiévale et la base de la tour médiévale |
|
|
|
|
|
|
|
75/ la base de la tour médiévale |
76/ la base de la tour médiévale depuis le sud |
77/ la base de la tour médiévale depuis le nord |
78/ l’enceinte ouest au sud de la Citadelle |
79/ la courtine de l’enceinte ouest |
|
|
|
|
|
|
|
80/ la jonction du mur d’enceinte avec le mur de la
Citadelle |
81/ vue de la Citadelle et de sa jonction avec le
mur d’enceinte depuis le sud |
82/ vue de l’enceinte ouest et de la Citadelle
depuis le Mamilla Mall |
83/ l’inscription datée 610/1213 conservée au Musée
National |
84/ l’inscription datée 587/1191 de la Qubba Yûsuf
sur le Haram |
Illustrations de l’enceinte du Mont Sion
|
|
|
|
|
|
|
1/ plan des
fouilles de l’enceinte sur le Mont Sion en 1894-1897 |
2/ plan de l’escarpement du sud-ouest de l’enceinte |
3/ plan des
fouilles sur l’escarpement du sud-ouest de l’enceinte en 2010 |
4/ sections des fouilles sur l’escarpement du
sud-ouest de l’enceinte en 2010 |
5/ plan des fouilles de la zone A et B sur
l’escarpement du sud-ouest de l’enceinte en 2010 |
Documents anciens
|
|
|
|
|
|
Plan de la ville en 1845 avec le tracé de l’enceinte Source : Kiepert (1845) |
Plan de la ville en 1864 avec le tracé de l’enceinte Source : Pierotti (1864) |
Plan de la ville en 1865 avec le tracé de l’enceinte Source : Wilson (1866) |
Plan de la ville en 1915 avec le tracé de l’enceinte Source : Smith/Bartholomew (1915) |
|
|
|
|
|
|
|
Panorama de la ville et de l’enceinte depuis le Mont
des Oliviers Source : Pierotti (1864) |
Vue de l’enceinte ouest avec Bâb al-Khalîl/Porte de
Jaffa et la Citadelle Source : Pierotti (1864) |
Vue d’une section de l’enceinte nord
Source : Wilson (1881), I |
Vue de la partie sud-ouest de
l’enceinte Source : Wilson (1881), I |
Vue du burj Kibrit
Source : Wilson (1881), I |
|
|
|
|
|
|
|
Vue de Bâb al-Khalîl/Porte de Jaffa d’après Ch.
Wilson Source : Wilson (1881), I |
Vue de Bâb Nabî Daud/Porte de Sion d’après Ch.
Wilson Source : Wilson (1881), I |
Vue de Bâb al-Rahma extra-muros d’après Ch. Wilson Source : Wilson (1881), I |
Vue de Bâb al-Rahma intra-muros d’après Ch. Wilson Source : Wilson (1881), I |
Vue de Bâb al-‘Amud/Porte de Damas d’après Ch.
Wilson Source : Wilson (1881), I |