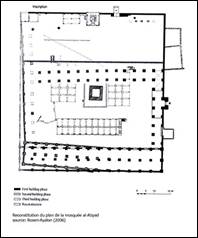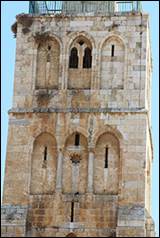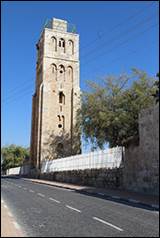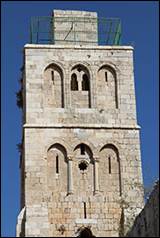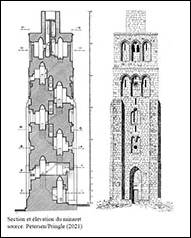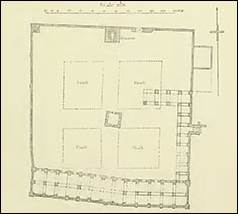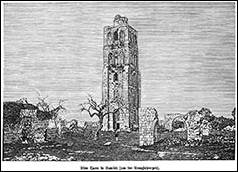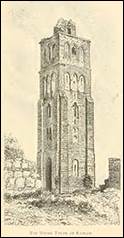Mosquée al-Abyad (666/1268)
Localisation : à l’ouest du cimetière Musulman de la rue Dani Mass.
Réf :
Conder/Kitchener (1882),
p.269-275
Guérin (1868), I,
p.40-46
Meinecke (1992), 4/128,
9C/81, 26B/14
Porter (1887), p.XV-XVI
Guérin (1868), I, p.40-46
RCEA 4588, 5401
Petersen/Pringle (2021), n°1, 5, 7, 8, 9 ; p.18
Tütünçü (2008), n°230, 233
Historique
La Mosquée al-Abyad (mosquée Blanche) est érigée peu de temps après la fondation de la ville par le calife Omeyyade Sulayman (r.715-717). Elle a connu quatre phases de construction et plusieurs rénovations révélées par une série de fouilles.[1] La mosquée Blanche a la particularité d’avoir des citernes voûtées creusées dans son sous-sol accessibles par des escaliers (ill.1).
Une inscription datée 586/1190 sur le mur nord mentionne la construction d’une mosquée qui devrait faire plutôt référence à la Grande Mosquée aménagée dans l’ancienne Cathédrale des Croisés qu’à la Mosquée al-Abyad.
Les deux séismes de 597/1200 et 598/1201 ont probablement entraînés quelques dégâts sur la salle de prière.
Après la conquête de Jaffa le 20 jumada 666/6.II.1268, le sultan Baybars (r.17 dhu’l-qa’da 658/24.X.1260 - 27 muharram 676/30.VI.1277) s’attelle à la restauration de l’édifice qui débute le 10 rajab 666/26.III.1268. Le minaret est restauré et la rénovation de la coupole du mihrâb et du portail est aussi entamée. Une inscription datée 666/1268, à l’ouest du minaret, commémore et raconte le siège de la ville de Jaffa par le sultan et mentionne aussi ces travaux.[2]
Au cour du séisme de safar 692/11.I-8.II.1293, le minaret de Baybars s’effondre ; plus tard au cours de son 3e règne, le sultan al-Nâsir Muhammad (30 ramadan 709/3.III.1310 - 21 dhu’l-hijja 741/7.VI.1341) fait élever un nouveau minaret avec de nombreux renforts de maçonnerie et des contreforts d’angle ; les travaux sont achevés au milieu de sha’ban 718/12.IX.1318 comme le mentionne l’inscription courant sur le portail du minaret (ill.10). Ce minaret carré d’une trentaine de mètres de hauteur s’élève sur cinq niveaux plus une plate forme (ill.30, 31) et présente un accès surmonté d’un assommoir (ill.9, 11), cette configuration a poussé de nombreux observateurs a en faire une tour de guet plutôt qu’une tour d’appel à la prière.[3]
Enfin, la citerne dans la cour de la mosquée est aussi restaurée en rabi’ I 810/6.VIII-4.IX.1407 par le gouverneur de la province de Damas Baighût al-Zâhirî (en poste du 1 rabi’ I 810/6.VIII.1407 jusqu’en 811/1408).
Aujourd’hui, il ne reste qu’une partie du portique est, le portique ouest est écroulé et le portique nord ne présente aucun vestiges apparents. La salle de prière (deux baies de profondeur et treize de large) est en grande partie effondrée et a perdu sa toiture (ill.17-28). Celle-ci présente des changements dans l’alignement du mur qibla (ill.1) suite aux travaux de rénovation de l’édifice. Le site a fait l’objet d’importantes fouilles.[4]
Epigraphie
586/1190. Texte de construction 5 lignes à l’angle nord-ouest (cette inscription concernerait la Grande Mosquée).[5]
In the name of God etc. This construction work
in this blessed mosque was ordered
by Iyās ibn ʿAbd Allāh, one of the company (ḥalqa) of the Emir ʿAlam
al-Dīn Qayṣar (may God have mercy
on him and on those who pray for his
soul), in the year 586 [1190].
666/1268. Texte de construction 4 lignes (400x30) sur l’accès droit du mur nord de la salle de prière de la Grande Mosquée.[6]
« In the name of God, the merciful, the compassionate. Only he shall inhabit
God’s places of worship who believes in God and the Last Day (Qurʾān
9.18). God, having decided to exercise His judgment, decided
in His foresight to permit His ready and trusted
servant, who relies on Him
to provide for him, who fights for Him, protector of the religion of
His prophet, and who loves Him and is His friend,
the illustrious great
sultan, the warrior, the defender of the borders, the
fighter at the frontier, the raider, pillar of the world and the faith
(Rukn al-Dunya waʾl-Dīn), sultan of Islam and the Muslims, Baybars son of ʿAbdallāh,
associate of the Commander of the Faithful
[i.e. the caliph], who came
from the land of Egypt with his victorious
army on the 10th of the month
of Rajab i, resolved to conduct holy war
and combat the infidels and resisters.
He descended on the port of Jaffa in the morning and conquered it by God’s will
in the third hour of that day. Then
he ordered the construction
of this dome over the blessed minaret and this doorway at this blessed mosque under the supervision of the one in need
of [lacuna where
the name of the supervisor
of the works has been effaced…
the year six and sixty] and
six hundred (ad 1268). May God
have mercy upon him and all Muslims. »
n.d. Décret 3 lignes sur la porte nord.[7]
« Decreed upon the order of our honoured suprême lord, Sultan
al-Malik al-Ẓāhir, may
God exalt him! / ... the honoured stables
as they were accustomed to do on their way to Damascus accompanied by ... / and so forth; and hindering whoever opposes them in Ramla including customs duty (maks), which they were not accustomed
to ... »
718/1318. Texte de construction 3 lignes sur le minaret (ill.10, 13, 14, 15).[8]
« …this blessed
minaret (miʾdhana) was
founded by our master, the victorious sultan (Sultan al-Nāṣir),
the wise, the just, the
warrior, the defender of the borders, the fighter at
the frontiers, sultan of Islam and the Muslims, the one who re-establishes justice in the worlds,
slayer of infidels and polytheists, king of the Arabs and the Persians [i.e. non-Arabs], master of the necks of nations (mālik
riqāb al-umam), guardian of God’s land, protector of the land and the faith,
father of conquest, (Nāṣir al-Dunya waʾl-Dīn Abū Fatḥ)
Muḥammad, son of our
lord, the martyred, the sultan, the victorious king, sword of the land and the faith (Sayf al-Dunya waʾl-Dīn)
Qalāwūn al-Ṣāliḥī,
associate of the Commander of the Faithful,
may God perpetuate
his days and hoist by victory his flags and banners. And the achievement of the building of it
was in the middle of the month
of Shaʿbān, the year
eighteen and seven hundred (October 1318) ».
n.d. Fragments d’inscription aux extrémités du bandeau sur le portail du minaret (ill.12, 16).[9]
« Shahada. Début Coran
IX :33 »
« The construction of
this place (makan) was … »
811/1408. Texte de restauration sur le mur de la citerne.[10]
Texte
non disponible.
Biblio complémentaire
Petersen (1995), p.75-101
Pringle (1998), p.185-187
Gibson/Vitto (1999)
Petersen (2001a), p.1-6
Petersen (2001b), p.345-359
Rosen-Ayalon (2002)
Aigle (2003), p.57-85
Rosen-Ayalon (2006), p.67-83
Cytryn-Silverman (2008), p.379-432
Cytryn-Silverman (2010a), p.1-7
Gutfeld (2010)
Herriott/Ilan (2017),
p.8-242
Petersen/Pringle (2021), p.117, n°16; p.185-201
|
|
|
|
|
|
|
1/ plan de la mosquée avec les phases de
constructions |
2/ le minaret depuis l’est |
3/ le minaret depuis le nord-est |
4/ le minaret depuis le nord |
5/ la partie haute du minaret, côté nord |
|
|
|
|
|
|
|
6/ le minaret depuis l’ouest |
7/ la partie haute du minaret, côté ouest |
8/ le minaret depuis le sud-est |
9/ portail d’accès au minaret, côté sud |
10/ le portail d’accès avec son inscription de
construction datée 718/1318 |
|
|
|
|
|
|
|
11/ l’assommoir aménagé au dessus de l’entrée |
12/ une inscription non datée à droite du portail |
13/ partie droite de l’inscription dans la baie du
portail |
14/ partie centrale de l’inscription |
15/ partie gauche de l’inscription |
|
|
|
|
|
|
|
16/ une inscription non datée à gauche du portail |
17/ vue générale des ruines de la salle de prière
depuis le minaret |
18/ partie gauche de la salle de prière depuis le
minaret |
19/ partie centrale de la salle de prière depuis le
minaret |
20/ partie droite de la salle de prière depuis le
minaret |
|
|
|
|
|
|
|
21/ vue partielle de la salle de prière |
22/ mur de qibla |
23/ arcade devant le mur qibla |
24/ le mur de qibla avec le mirhâb |
25/ arcade de la salle de prière |
|
|
|
|
|
|
26/ arcade de la salle de prière |
27/ détail d’un arc |
28/ mur de qibla depuis l’extérieur |
29/ une partie des arcades latérales |
|
|
|
|
|
|
|
30/ plan des niveaux du minaret |
31/ section et élévation du minaret |
32/ le minaret depuis la salle de prière |
33/ partie haute du minaret depuis la salle de
prière |
34/ le minaret depuis l’est de la cour |
Documents anciens
Guérin (1868), I, p.40-46.
En dehors des limites de cette enceinte, je
signalerai comme particulièrement dignes d'attention : la mosquée que les
musulmans appellent vilguairement Djama' el-Abiyadh (la mosquée
Blanche), et que les Latins désignent sous le nom de ‘couvent des Templiers’ et
‘tour des Quarante Martyrs’ […]
Le Djama’ el-Abiyadh se trouve à huit
minutes à l'ouest delà ville. Devant cette mosquée s’étend un grand musulman,
ombragé cà et là par de vieux seder […]
L'enceinte de la mosquée Blanche mesure cent
six pas de long sur cent de large. Quelques voyageurs en ont singulièrement
exagéré l'étendue. Le long de la face sud de ce rectangle, deux rangées
d'arcades ogivales sont ou debout ou à moitié écroulées. Vers le milieu de
cette espèce de nef, une niche marque le milirab. Sur une belle pièce de marbre
gisante à terre et que l'on a essayé de scier vers le centre pour l'emporter,
on lit une inscription arabe, dont voici la traduction, que je dois également à
l'extrême obligeance de M. Sauvaire :
« Au nom de Dieu clément et
miséricordieux, ceux-là seuls entretiennent les temples de Dieu qui croient en
Dieu et au jour dernier. Lorsque Dieu (il est puissant et grand) désira
l'exécution de son jugement arrêté dans sa prescience,
il autorisa son humble serviteur, qui met sa
confiance en lui et s'en remet à lui pour ses affaires, le champion de sa
cause, le défenseur de la religion de son Prophète, de son bien-aimé et de son
ami, le Sultan illustre, grand, zélé
pour la guerre sacrée, guerrier, conquérant,
victorieux, la colonne du monde et de la religion, le sultan de l'Islamisme et
des Musulmans, Bibars, fils d'Abdallah, auxiliaire de l’Émir des croyants (que
Dieu lui accorde une longue
existence !), et celui-ci sortit d’Egypte, à la
tête de son armée victorieuse, le dixième jour du mois de redjeb l'unique, avec
l'intention d'entreprendre la guerre sainte, d'attaquer les polythéistes et les
opiniâtres, Il vint camper devant
la place frontière de Jalïa, le matin du jour,
et s'en rendit maître, par la permission de Dieu, à la troisième heure. Puis il
ordonna de construire cette coupole au-dessus de ce minaret béni, et cette
porte pour servir à ce djanié béni, par les soins de l'humble en l'année 666
(1268 de J. C) ».
Devant celte partie du haram ou de l'enceinte
sacrée, restaurée et embellie par Bibars, s'étend un souterrain parfaitement
conservé, dont les voûtes reposent sur deux rangées d'élégantes arcades
ogivales. Je suis tenté d'y voir d'anciennes citernes, comme semble le prouver
l'excellent ciment dont elles sont encore en partie revêtues ainsi que les
ouvertures supérieures qui les éclairent et par lesquelles on pouvait puiser de
l'eau. D'autres voyageurs pensent
que ce sont là des magasins. Les musulmans
prétendent que ce souterrain contient les restes sacrés de quarante compagnons
de Mahomet, morts martyrs en combattant pour la foi musulmane, et ils n'y
descendent qu'avec respect. D'un autre côté, une tradition latine le regarde
comme étant la crypte d'une église chrétienne élevée autrefois en l'honneur des
quarante martyre de Sébaste en Arménie, dont les reliques auraient été
transportées partie en Italie et partie en Palestine. […]
Mais poursuivons l'examen de l'enceinte sacrée
: une seule rangée d'arcades, à moitié démolies et de forme ogivale, longe la
face orientale, laquelle, à son centre, est percée d'une porte qui regarde la
ville. Devant ces arcades régnent de grandes citernes dont les voûtes sont
soutenues par deux rangs d'arcades superposées; une partie de ces citernes,
regardées pareillement par d'autres voyageurs connue d'anciens magasins, est
bien conservée ; le reste est écroulé.
Au milieu de la face occidentale s'élève une
tour justement renommée et appelée vulgairement tour des Quarante-Martyrs. Elle
est isolée et n'a jamais été attenante à une église. Tous les voyageurs
admirent l'élégante simplicité de sa construction. De forme quadrangulaire,
elle mesure approximativement neuf mètres sur chaque face. Les pierres qui la
composent sont de dimension moyenne, mais régulières et bien agencées. On y
monte par un escalier en spirale de cent vingt degrés. Les fenêtres qui
l'éclairent sont étroites et ogivales. Elle n'a jamais pu intérieurement
renfermer de cloches. Ce n'est donc pas un campanile d'église ni un beffroi,
mais plutôt un minaret musulman. Sa plate-forme supérieure est aujourd'hui très
endommagée par le temps. C'est de là qu'autrefois le muezzin annonçait l'heure
de la prière ; de là aussi, en temps de guerre, on découvrait au loin
l'approche de l'ennemi. De ce point, en effet, le regard embrasse un horizon
dont tous les voyageurs ont, à juste titre, vanté la beauté et l'étendue. A
l'ouest, Jaffa et la Méditerranée ; au nord et au sud, de vastes et fertiles
plaines ; à l'est, le rideau accidenté des montagnes de la Judée et de la
Samarie, sollicitent tour à tour l'attention. Lorsque je fis l'ascension de ce
minaret, j’assistai, en outre, de son sommet, à l'un des couchers de soleil les
plus splendides que j'aie jamais vus, ce qui ajoutait un charme particulier à
la grandeur du panorama que j'avais sous les yeux. En même temps qu'à
l'occident le disque empourpré de l'astre du jour descendait lentement dans les
flots de la mer, dont il teignait la surface de ses feux mourants, à l'orient
la lune se levait radieuse du sein des monts de Juda, et sa lumière argentée
répandait partout un éclat doux et mystérieux.
Quand et par qui cette tour a-t-elle été
construite ? D'après une tradition généralement accréditée parmi les chrétiens,
elle aurait été bâtie, à l'époque des croisades, par les Templiers, pour servir
de clocher à une église maintenant détruite et dont la crypte seule existerait
encore. Cette église, comme je l'ai déjà dit, aurait été dédiées aux Quarante
Martyrs de Sébaste, et l’enceinte entière du Djama' al-Abyadh serait
celle de leur couvent, transformé plus lard
en mosquée.
Mais cette tradition, notanunent en ce qui
concerne la tour, me parait contredite ; et par le monument lui-même et
par l'histoire. Le monument, en effet, par l'appareil, par les moulures qui
encadrent les fenêtres supérieures et par le galbe de la porte, semble accuser
un travail arabe. De plus, sur le linteau de cette porte on lit l'inscription
arabe suivante, dont voici la traduction, que je dois de même à M. Sauvaire :
« Au nom de Dieu clément et
miséricordieux, ceux-là seuls entretiennent les temples de Dieu qui croient en
Dieu et au jour dernier, observent la prière et font l’aumône, et qui ne
craignent que lui. L'édification de ce minaret béni a eu lieu par l'ordre de
notre maître le Sultan, roi défenseur, savant, juste, zélé pour la guerre
sacrée, guerrier, défenseur des frontières, sultan de l'Islamisme et des
Musulmans, vivificateur de la justice dans l'univers, exterminateur des
infidèles et des polythéistes, roi des Arabes et des Persans, maître des
nations, conservateur du pays de Dieu, défenseur du monde et de la religion,
Abou'l-Fetah (père de la victoire), Mohammed, fils de notre maître le Sultan
martyr, le roi victorieux, épée du monde et de la religion, Kelàoun Sàlehy,
auxiliaire de l'Émir des croyants (que Dieu fasse durer ses jours et favorise
de la victoire ses drapeaux et ses étendards !). La construction de ce minaret
a été achevée au milieu du mois de chàban de l'année 718 (1318 de J. C) ».
En second lieu, cette tour ne semble pas avoir
été bâtie pour renfermer des cloches, et, par conséquent, on ne peut y voir le
clocher d'une église aujourd'hui démolie. On pourra m'objecter que
l'inscription que je viens de rapporter
n'est peut-être pas plus véridique que celle
qui a été placée au-dessus de la porte septentrionale de l'ancienne église de
Saint-Jean, transformée ensuite en mosquée, et qu'elle a pu être gravée, de
même, après coup. Mais ici l'histoire est d'accord avec l'inscription. Nous
lisons effectivement dans L’Histoire de Jérusalem et d'Héhron, par Medjr Eddhi,
ouvrage terminé l'an 901 de l'hégire (1494 de J. C.), au folio 209 : Tous
les édifices de Ramleh sont en ruine. L'ancienne mosquée se trouve hors de la
ville, à l'ouest, et est attenante à un cimetière. Le sultan El-Malek en-Naser
Mohammed ebn-Kelâoun y a construit un minaret qui est une des merveilles du
monde pour la forme et l'élévation. Les voyageurs rapportent qu'il n’a pas son
pareil. Il fut achevé au milieu de chàban de l'an 718 de l’Hégire.
Ce djama' a été construit par un khalife
ommiade, Soliman ebn-Abd el-Malek, lorsqu'il monta sur le trône, en l’an 96 de
l’Hégire. C’est un djama' fréquenté et vaste. Il est en grande vénération; on
l’appelle Djama el-Ahiyâdh.
Ce dernier passage nous apprend que, bien avant
les croisades, les musulmans avaient érigé une mosquée en ce lieu. Pendant
l'occupation du pays par les Latins, ce sanctuaire put sans doute être converti
en église; mais ensuite, sous le règne de Saladin, il retomba au pouvoir des
musulmans, et fut réparé, en 1190, par l'un des personnages de sa cour.
Tout semble donc prouver qu'ici la tradition
musulmane est fondée et que les ruines du Djama' el-Abyadh sont
d'origine arabe. La tour, les citernes ou magasins, les rangées d'arcades que
j'ai mentionnées, deux koubbeh délabrées ou chapelles de santons, dont je n'ai
point encore parlé et qui occupent à peu près le milieu de l'enceinte sacrée,
plusieurs logements à moitié démolis, en un mot tout l'ensemble de ce haram,
qui semble avoir été à la fois une mosquée et un khan, dénote, à mon avis, des
constructions musulmanes et non point chrétiennes. Et, de même qu'à propos du Djama'
el-Kebir, malgré l'inscription gravée au-dessus de la porte, je
revendiquais pour cet édifice l'honneur d'avoir été primitivement une église
chrétienne, dont toutes les dispositions générales sont conservées et
reconnaissables, de même pour le Djama' el-Abyadh, je suis très-porté à
croire que la tradition chrétienne est erronée et que si les Templiers ont eu
là un de leurs couvents, à l'époque des croisades, si alors ils y ont dédié une
chapelle aux quarante martyrs de Sébaste, ce que je ne nie pas, ce n'est point
à eux néanmoins qu'il faut rapporter la tour que je viens de décrire, ni les
autres ruines qui remplissent cette enceinte.
Conder/Kitchener (1882), p.269-275. Visite le 17
janvier 1874.
The White Mosque. The enclosure measures about 300
feet north and south, by 280 feet east and west. The fine minaret, commonly called
' Tower of the Forty Martyrs ' by Christians, is in the centre of the north side
; along the south wall is a double colonnade with pointed arches. There is a mihrâb
in the south wall. Beneath the surface are three vaults, running cast and west,
with pointed arches. To one of these the title Arbain Meghazi, Forty Champions (companions
of the Prophet), applies. This vault is full of Meshahed, or cairns, erected by
pilgrims. A small ruined building or chapel stood in the centre of the court. The
minaret has a winding staircase and solid core of masonry.
Masons' marks were observed on the slabs used for
steps, which were probably taken from one of the tenth century churches, destroyed
before the building of the mosque. The tower has been severely shaken by earthquake.
The height is 120 feet, and the base is 26 feet square. The masonry is remarkably
fine throughout.
Near the southern arcade is a long block of grey
marble having an Arabic inscription, which was thus translated by Mr. Tyrwhitt Drake
:
« In the name of God, the merciful, the compassionate.
None restores the mosques of God but he who believes in God and in the last day.
And God, whose majesty be exalted, allowed the issuing of the mandate because of
the knowledge which he had before permitted His servant, the poor one who relies
on Him and turns to Him in all his deeds, who is zealous in His ways, Nasr ed Din,
Defender of the Faith and His Prophet, and the .... of his friend, the most majestic
Sultan, the Wise, the Crescentator, the Preserver, the Fortifier, the Defender of
the Faith, in this world and the next, the Sultan of Islam and of the Moslems, Bibars,
Ibn Abdallah Kasim, Commander of the Faithful, may God spare him to us. And he sallied
forth with his victorious army on the 10th of Rejeb el Ahed from Egypt, in order
to go on a holy war and a raid on the men of sin and obstinacy ; and he halted at
the fort of Yafa
in the beginning of the day, and he conquered it
by the permission of God at 3 o'clock (9. a.m.) of the same day. Then he
ordered that this dome should be begun over the lanthorn .... by the hand of Khûlil
Ibn Dhûr . . . . May God pardon his son and his parents .... in the year six and
sixty and six hundred and on the Moslems ».
Bibars took Jaffa and Ramleh in 1268 from the Christians,
according to William of Tyre.
Over the door of the mosque is another inscription,
with the date 718 A.H., the same given by Mejr ed Din for the completion of the
mosque. The inscription gives the name of the founder as Abu’1-Fath, son of our
Lord the Sultan, the martyr el Melek el Mansur. The latter is the title of the Sultan
Kala'un by whose son, Nasr Muhammed, the mosque was founded, according to Mejr ed
Din. His full title was Nasr Abu’1-Fath Muhammed Ibn Kala'ûn.
There are remains of chambers, probably
occupied by the ministers of the mosque, along the west wall.
All the arches are pointed, the roofs are groined,
the masonry is small.
In the centre of the area is a square building about
26 feet wide. In the north-west corner is the little kubbeh of Sheikh Saleh.
There is a gate on the north and another on the
east, also remains of a central colonnade running east and west.
Visited 17th January, 1874.
Porter (1887),
p.XV-XVI. Visite entre 1849 et 1859.
Ramleh is
now before us, a bustling little town of some three thousand people. Its houses
are substantial, and its streets wider and cleaner than in most Oriental towns.
There are
two buildings of considerable interest ;—a church of the Crusading age, now a mosque;
and a tall tower, visible over the whole Plain of Sharon. […] About a quarter of
a mile west of the town is the White Tower, surrounded by the ruins of a large mosque.
The tower, now isolated, is square, and beautifully built. The angles are supported
by slender buttresses, and the sides taper upwards in stories. A winding staircase
leads to the top, where it opens on an external stone gallery. The height is about
one hundred and twenty feet. An Arabic inscription over the door of the tower ascribes
its erection to Sultan Mansur, and gives a date equivalent to a.d. 1318.
The view
from the top is very fine, commanding the whole of Ramleh and the gardens out
to Lydda, as well as the great road westward to the orchards of Joppa, and eastward
be defile which leads to Jerusalem.
|
|
|
|
|
|
|
Vue du minaret de la mosquée al-Abyad Source : Garvey (1880) |
Vue du minaret de la mosquée al-Abyad Source : Wilson (1881), III |
Plan de la mosquée d’après le Survey of Western Palestine Source : Conder/Kitchener (1882) |
Vue du minaret de la mosquée al-Abyad Source : Ninck (1885) |
Vue du minaret de la mosquée al-Abyad Source : Porter (1887) |